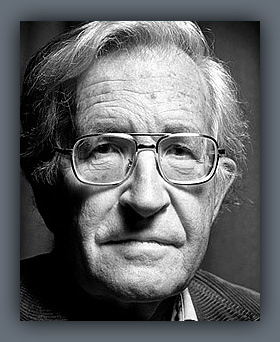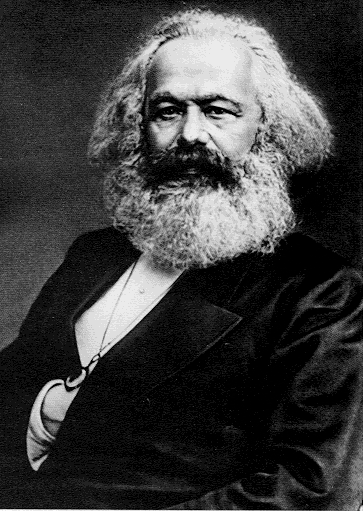La fin de l'année approche à grand pas, et entre deux festins il convient comme toujours de faire le bilan de l'année écoulée, de considérer les erreurs commises et de se fixer des objectifs (résolutions) pour les prochains 365 jours. Il en est de même en Histoire, et l'année 2009 s'y prête à merveille.
Le 21ème siècle a commencé sur une note de triomphalisme américain, une apparente victoire du libéralisme économique et politique contre tous ses adversaires, et les prédictions de Fukuyama sur une "fin de l'Histoire", bien que radicalement optimistes, ne sonnaient pas encore complètement faux dans le contexte de début 2001.
Huit ans plus tard, et tout est à revoir. Après les attaques du 11 septembre les néo-conservateurs de l'administration Bush ont fait du terrorisme le nouvel ennemi à abattre et les islamistes sont les communistes d'aujourd'hui, un ennemi tant intérieur qu'extérieur pour les démocraties libérales. Une invasion "préventive" de l'Iraq plus tard et le prestige américain acquis à l'effondrement de l'URSS a volé en éclats, et le modèle occidental qu'on a voulu imposer de force au Moyen-Orient est apparu d'autant plus vulnérable, de telle sorte que Fukuyama a du renier les néo-conservateurs qui l'avaient porté aux nues. La crise économique de 2008 a achevé de sceller le sort de tout triomphalisme hâtif, montrant les limites d'une croissance basée sur l'endettement, la spéculation, et la confiance abusée. La mort toute récente de Samuel Huntington enfin, qui prédisait lui une division de l'humanité par les divisions culturelles (Le choc des civilisations), nous rappelle que l'économie a encore une importance toute relative quand on considère l'avenir du monde.
Avec l'élection d'Obama comme leader de la première puissance mondiale, une page paraît se tourner. En fait, c'est plutôt un recommencement. Certes, l'Occident a retrouvé une mesure de confiance envers les principes universels de l'idéologie américaine mais les années à venir de l'administration Obama seront aussi celles de la fin de la suprématie américaine et de l'émergence définitive de nouvelles puissances. Ce sera la résurgence du paradigme idéologique qu'on a cru enterré en 1991, la remise en question de la démocratie libérale par des idées qui, il faut bien l'avouer, ne sont jamais qu'une redécouverte du marxisme. En Asie ou en Amérique du Sud, le collectivisme sera sans doute préféré à l'individualisme acharné que l'on cherche encore à nous vendre en Europe. La prédominance mondiale de l'économie comme régulatrice des rapports sociaux ne sera pas, et ne sera sans doute jamais. Henry Kissinger dans le prestigieux The Economist, parle de la "fin de l'hubris" et annonce un pragmatisme forcé, un nouvel équilibre entre réalisme et idéalisme, entre la nécessité de la gestion étatique et l'utopie libérale. La "fin de l'hubris", c'est finalement la remise à sa place du capitalisme. Les conséquences en sont déjà prévisibles: renforcement de l'alter-mondialisme, une crédibilité accrue pour les critiques en tous genres du système établi, et peut-être même un peu d'originalité américaine.
Car est-ce vraiment Obama que l'on attend? Certes, il représente à lui tout seul un changement radical de voie pour les américains, mais est-ce vraiment pour cela que le monde le plébiscite?
Plus encore qu'une administration Démocrate digne de ce nom, c'est une reformulation des principes américains que l'on attend, une revitalisation d'une idéologie qui a, somme toute, échouée.
Car 1991 a peut-être vu l'échec d'une certaine forme de communisme totalitaire, mais 2008 ressemble fort à l'échec d'un certain libéralisme. Ainsi la roue tourne, et l'Histoire continue avec elle, remise à zéro l'espace d'un instant dans les bulles d'une coupe de champagne.